Questions et réponses
Réponses aux questions fréquemment posées et aux doutes concernant les projets européens

Faire connaissance avec le guide
Le guide est-il gratuit ?
Oui, le guide Europlanning est une plateforme gratuite : tout le monde peut y accéder, récupérer du matériel, poser des questions, participer à des initiatives.
Dois-je avoir des connaissances de base pour lire le guide ?
Dans la mesure du possible, le guide Europlanning adopte un langage simple et clair qui ne nécessite pas de compétences de base particulières.
Pour ceux qui abordent les sujets traités pour la première fois, nous vous recommandons de commencer la lecture du manuel en suivant l’ordre des chapitres.
Puis-je télécharger les documents du guide ?
Le guide est ouvert à tous et toujours en ligne.
Nous vous recommandons de le consulter en ligne à partir de ce site : c’est l’expérience de lecture la plus complète et elle vous permet d’approfondir les sujets grâce à des liens internes et externes. La plateforme est conçue pour une lecture efficace à partir de n’importe quel type d’appareil.
Si cela facilite la lecture, les chapitres et les articles du guide peuvent être facilement imprimés, soit en version papier, soit sous forme de fichier pdf. Sur chaque page, vous trouverez une barre spéciale pour le partage des documents, qui comprend également un symbole d’imprimante.
Puis-je utiliser et partager les documents du guide ?
Oui, sous certaines conditions.
Le matériel contenu dans le guide peut être utilisé à volonté et partagé librement sur n’importe quel support ou dans n’importe quel format, à condition que la source soit citée et qu’il ne soit pas redistribué à des fins commerciales ou sous des formes modifiées.
La licence de référence est Creative Commons 4.0 (Attribution – Noncommercial – No Derivative Works) : https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Sur chaque page, une barre spéciale permet de partager rapidement des documents via différents réseaux sociaux.
Que puis-je trouver dans le guide Europlanning ?
Le guide est organisé en trois sections principales.
1. Un manuel : les bases, la structure et la méthode pour travailler avec les fonds et programmes européens. Il est divisé en chapitres, comme un livre. Il est idéal pour ceux qui veulent comprendre le fonctionnement des fonds et programmes européens de manière ordonnée (partie 1), pour ceux qui veulent comprendre comment sont organisées les différentes « familles » de fonds et programmes européens (partie 2), et pour ceux qui veulent approfondir leur approche, leurs méthodes et leurs outils pour travailler sur des projets européens (partie 3).
2. Les programmes : un point d’accès rapide à des informations et des liens spécifiques aux programmes. Chaque programme européen et chaque programme géré au niveau régional ou national est décrit dans une brève fiche d’information, qui fournit une description et une répartition des ressources. La partie la plus importante de chaque fiche est constituée de liens permettant d’accéder directement aux règlements, aux documents de programmation, aux appels à propositions, aux résultats, aux informations et à bien d’autres choses encore.
3. The Insights : des nouvelles, des outils, des interviews et des ressources pour aller plus loin. Les outils comprennent une page d’appels (couvrant la programmation européenne, régionale et nationale), un glossaire, des critiques de sites, de plateformes et de documents intéressants, ainsi qu’une section de questions et réponses pour un accès plus rapide aux informations les plus importantes.
Puis-je contacter le personnel du guide ?
Bien entendu, l’équipe du Guide est à l’écoute des commentaires, des questions et des propositions des lecteurs, qu’il s’agisse d’utilisateurs expérimentés (pour des conseils et des demandes spécifiques) ou de ceux qui abordent les projets européens (pour des questions de base). En règle générale, nous n’apportons pas de soutien à la rédaction de projets ou à des questions purement opérationnelles : nous donnons la priorité aux questions et aux propositions qui pourraient également intéresser d’autres utilisateurs du Guide.
Vous pouvez nous trouver sur notre page de contact, sur Facebook et sur LinkedIn.
Puis-je adhérer au Guide Europlanning ?
Le partenariat du guide est constitué de fondations et d’organisations apparentées. Nous sommes ouverts à de nouveaux partenaires, en particulier 1) des fondations et organisations apparentées et 2) des partenaires capables d’enrichir le contenu du Guide avec de nouvelles propositions, ou de promouvoir son utilisation parmi des catégories spécifiques de bénéficiaires potentiels (par exemple, les universités, les masters, les centres de formation, les organisations du troisième secteur et les associations).
Vous pouvez nous trouver sur les pages « À propos de nous » et » Contact ».
Pourquoi écrivez-vous le guide Europlanning ?
Les Fondations et les organisations partenaires actuelles du Guide travaillent statutairement pour le développement du territoire. Elles partagent une vision : celle d’agir comme un « pont » entre les dimensions locale et internationale, en créant des réseaux et des liens entre les projets et les ressources.
Les fonds européens sont un levier extraordinaire pour renouveler le pays et construire un avenir plus durable : un défi et une grande opportunité, auxquels les partenaires du Guide répondent en mettant à disposition un outil gratuit, innovant et ouvert à tous.
Que font les partenaires du Guide pour promouvoir les projets européens sur leur territoire ?
Parallèlement au Guide, et en utilisant le Guide comme outil de travail et de sensibilisation, les Fondations partenaires interviennent dans leurs territoires respectifs avec une série d’initiatives intéressantes : SfidEuropee (Nord-Est) Attrazione Risorse (Cuneo) Atelier di Europrogettazione (Perugia) Sportello Europa (Florence, Arezzo et Grosseto) BEEurope et Cofinancement de projets européens (Lombardie, Novara et VCO).
Travailler sur des projets
À qui puis-je m'adresser pour obtenir du soutien, de l'inspiration et des informations sur mes projets ?
Il existe de nombreuses réponses à cette question. Nous les avons examinées dans un chapitre distinct de notre manuel : Lisez-le ici
Nous vous en proposons quelques-unes : 1. desinitiatives de soutien spécifiques dans votre région.Consultez ici les initiatives organisées par les partenaires du Guide ; 2. Lespoints de contact nationaux, qui apportent un soutien à de nombreux programmes européens.Découvrez ici ce qu’ils sont et qui contacter ; 3. Lesorganisations faîtières actives au niveau européen dans de nombreux domaines, qui sont utiles pour trouver des opportunités et des partenaires.Découvrez ici qui elles sont et comment les contacter ; 4.Les points de liaison entre les institutions et les citoyens : EuropeDirect, EEN, Parlement européen, Commission européenne, ItalRap; 5. Les agences, les directions générales et les fonctionnaires de la Commission (avec toute l’attention requise).Découvrez comment ici ; 6. Les responsables d’Europrojets et les entreprises spécialisées.Découvrez ici quand et comment ils peuvent vous aider.
Où puis-je trouver des conseils utiles, des sources et des plateformes pour me tenir au courant des projets européens ?
Il existe de nombreux moyens de se tenir informé et à jour. Chaque secteur a ses propres particularités et organisations cibles ; chaque organisation a ses propres réseaux, objectifs et approches. Nous avons abordé cette question dans un chapitre distinct de notre manuel : lisez-le ici.
Notre Guide propose divers outils et possibilités, parmi lesquels en particulier : 1. une section spéciale pour découvrir et approfondir (grâce à des liens directs vers les sources officielles) tout ce qui concerne lesprogrammes individuels; 2. unepage sur les appels à propositions qui rassemble les principales opportunités, directement à partir des canaux officiels Funding&Tenders et OpenCoesione ; 3.
une proposition régulière d’actualités et d’analyses approfondies, résumées dans une lettre d’information mensuelle ; 4. une sectionAudio et Vidéo et un article consacré aux principaux événements et aux sources d’informations en direct et en vidéo ; 5. une sectionGuides et Outils, qui propose d’autres sources d’informations à suivre régulièrement.
Où puis-je trouver des partenaires et des exemples pour mes projets ?
Les bons partenaires et les bonnes inspirations peuvent être découverts presque partout, mais il n’est pas facile de trouver les bons.
Quel que soit votre secteur, restez en contact avec les principaux réseaux, associations et organisations les plus actifs et représentatifs dans votre domaine d’activité. Développez des échanges et des contacts avec des organisations similaires actives dans votre région et en Europe. La participation à un réseau régional, national ou (pourquoi pas ?) européen peut ouvrir la voie à un grand nombre d’opportunités. Utilisez des plateformes appropriées pour la recherche de partenaires et pour l’analyse de projets déjà mis en œuvre.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Nous avons également abordé cette question dans un chapitre distinct de notre manuel.
Quelle est la particularité des projets européens ?
Le Guide Europlanning explique et fournit des outils pour travailler sur la conception, la rédaction, la soumission et la gestion de projets en réponse à un appel à propositions lancé dans le cadre d’un programme ou d’un fonds européen.
Les projets européens présentent de nombreuses similitudes avec d’autres types de planification réalisés au niveau local et international, mais ils suivent des règles spécifiques dérivées de la structure institutionnelle et des politiques de l’Union européenne, ainsi que d’un ensemble de pratiques et d’usages qui se sont accumulés et ont évolué au fil des décennies. Elles prévoient une « taxonomie » des fonds et des programmes qui évolue régulièrement (notamment à chaque période de programmation de sept ans), à laquelle sont associés des règlements spécifiques, des politiques de référence, des documents de programmation et des institutions responsables. Elles prévoient des procédures spécifiques de préparation, de gestion et d’établissement de rapports, ainsi que des outils et des systèmes de soutien pour les demandeurs de projets.
Le Guide Europlanning vise à expliquer, promouvoir et rendre plus accessibles ces informations, ces méthodes de travail et ces outils.
Comment approcher les fonds européens ? Les projets européens sont-ils "pour moi" ?
Aborder les projets européens nécessite une « vision européenne », une bonne connaissance du secteur concerné, une capacité à rassembler et à organiser l’information, une propension à créer des liens et des partenariats, de la rigueur et de l’innovation… et bien d’autres choses encore.
Notre guide vous donne les bases, l’accès aux informations les plus importantes, des exemples, des mises à jour et des bonnes pratiques, ainsi que les outils pour approfondir et démarrer dans le monde des projets européens. Certains types d’appels – et surtout une approche informée et consciente des projets européens – permettent même aux plus petites organisations de saisir cette importante opportunité.
Découvrez comment en lisant l’article complet.
Comment rechercher (et trouver) des appels à propositions européens ?
Il s’agit d’une question prioritaire pour les « initiés ». Il est nécessaire de garder un œil sur les programmes les plus intéressants dans son propre domaine d’action, d’utiliser les informations provenant des documents de planification (par exemple les programmes de travail annuels ou pluriannuels) et d’utiliser les outils disponibles pour promouvoir les appels publiés et arrivant à échéance.
Les principaux outils sont les suivants :
La section Appel d’offres de notre guide, le service InfoBandi de CSVnet et nos aperçus des programmes européens, des fonds structurels et ruraux et de la coopération territoriale.
Les sources officielles, à savoir les portails Funding&Tenders, OpenCoesione et les pages des institutions responsables, qui permettent aujourd’hui de rechercher des appels d’offres de manière relativement simple et directe.
Pour en savoir plus, lisez les articles sur la recherche d’appels à propositions européens et sur la façon de se tenir au courant.
Les principales informations sont incluses dans la section dédiée du manuel.
Est-il préférable d'attendre l'appel parfait pour votre idée ou d'élaborer l'idée à partir de l'appel ?
La réponse à cette question se situe quelque part entre deux approches différentes.
D’une part, il est essentiel d’analyser soigneusement les critères d’un appel et son objectif. D’autre part, le projet doit être l’expression d’une activité ressentie, bien structurée, précise et orientée, répondant à des besoins réels et significatifs.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Comment s'inscrire pour participer à un projet européen ?
La quasi-totalité des projets européens de financement direct sont désormais soumis par voie électronique, notamment via le portail Funding and Tenders de la Commission européenne.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Quels sont les ingrédients d'un bon projet ? Comment les projets européens sont-ils évalués ?
Un projet qui a de bonnes chances de réussir est avant tout un projet
– présenté de manière simple, claire et avec un cadre logique bien structuré – cohérent avec l’appel à propositions, avec les intentions du financeur, avec la réponse à des besoins réels et significatifs – solide en termes de partenariat, de ressources humaines et matérielles, de concrétisation du plan d’action – qui peut offrir « quelque chose de plus », de différent ou de meilleur que ce que d’autres font déjà – qui répond de manière convaincante aux critères de Pertinence, d’Efficience, d’Efficacité, d’Impact et de Durabilité.
Mais c’est aussi (ce qui n’est jamais évident) un projet soumis dans les délais et correct d’un point de vue administratif et procédural.
Pour en savoir plus, lisez l’article complet et notre manuel.
Quelles sont les bonnes questions pour un bon projet européen ?
Notre guide consacre une large place à la « manière de penser » les projets européens et tente de répondre aux nombreuses questions concernant le domaine de l’Europlanning.
Il y a cependant des » questions peu fréquentes » que l’on ne se pose pas souvent dans le cadre des projets européens, mais qui peuvent faire toute la différence. Des principes qui deviennent extrêmement concrets une fois qu’ils sont posés et visualisés dans la vie de nos projets. En voici quelques-uns, tirés des » questions peu fréquentes » du Guide OpenPM2.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Comment gérer la création de partenariats et la collaboration dans les projets européens ?
Les projets européens sont de grands « travaux de groupe » qui nécessitent une interaction continue entre les personnes, les groupes et les organisations, tant dans la phase de conception que dans la phase de mise en œuvre. Cette interaction permet d’élargir la portée et la qualité des interventions, d’apprendre les uns des autres et d’innover, mais elle représente également un élément de complexité supplémentaire qui peut générer du stress et des conflits potentiels.
Pour que cette interaction soit un facteur de réussite, il convient de prendre en compte différents aspects et questions clés : analyser et impliquer les partenaires et autres acteurs liés au projet de la bonne manière, comprendre leurs formes d’interaction, leur associer des rôles et des responsabilités.
Il est également nécessaire de définir et d’appliquer des règles communes, formalisées dans un accord de consortium.
Découvrez tout cela dans un article et une section dédiés.
Comment le suivi et l'évaluation sont-ils organisés dans le cadre d'un projet européen ?
L’un des principaux défis de la gestion des projets européens consiste à contrôler l’avancement des activités, l’utilisation des ressources, le respect des délais, l’obtention des résultats et des objectifs et, en fin de compte, l’obtention de l’impact.
Tout ceci est au cœur du lien entre la personne qui soumet un projet européen et l’autorité de gestion qui le finance, et peut avoir un poids considérable dans la sélection (et la gestion ultérieure) des projets européens. Tout d’abord, cela nécessite une bonne définition de la logique d’intervention, à travers un Cadre Logique et un Cadre de Suivi et d’Evaluation spécifique, avec des indicateurs, des sources, des moyens et des méthodes de vérification, des niveaux de référence et des cibles, des calendriers et des responsabilités. Cette activité se poursuit dans la phase de gestion du projet à travers des outils et des méthodes d’analyse, de collecte et de traitement des données appropriés. Elle prend une valeur stratégique et de « bilan final » lorsqu’il s’agit de définir et de mesurer l' »impact » du projet.
Découvrez son fonctionnement dans lasection appropriée.
Comment fonctionne le reporting dans les projets européens ?
Le reporting est l’un des concepts les plus fréquemment associés au monde des projets européens. Il s’agit du rapport financier du projet, mais il est étroitement lié à tous les aspects de la vie du projet : planification, gestion, proposition et budgétisation, exécution des activités, relations avec les partenaires et diverses activités administratives (documentation des employés, des consultants et des fournisseurs, preuves de paiement, archivage des documents et comptabilité).Il s’agit d’une activité importante et nécessaire pour obtenir des fonds européens.
Découvrez son fonctionnement dans lasection appropriée.
Par où commencer pour élaborer une proposition de projet ?
La définition d’une bonne idée de projet est d’une importance fondamentale pour le développement ultérieur du projet.
Elle nécessite
– une activité préalable d’analyse du contexte, des besoins auxquels on entend répondre, des intentions de ceux qui le financent, de ce qui a déjà été fait dans le même domaine, des ressources humaines et matérielles disponibles ; – une approche claire dans l’identification des objectifs, des résultats et des facteurs qui pourraient conditionner le résultat (cadre logique)
– une parfaite connaissance de l’appel à propositions, des formulaires de référence, des critères formels et administratifs de participation et des besoins en temps et en ressources ; – une activité d’échange et d’association avec d’autres organisations, afin de former un partenariat qui apporte des idées, des approches, des compétences, des ressources et une évolutivité territoriale.
Découvrez tout cela dans quatre chapitres successifs consacrés à la préparation, à l’approche, à la structuration du projet et aux exemples et réflexions.
Que contiennent un appel et une proposition de projet ?
La structure des appels à propositions varie en fonction du type de programme (régional, national ou gestion centralisée) et des spécificités des programmes individuels. Ils comprennent normalement des lignes directrices, des formulaires et des modèles (pour les propositions et les budgets), des indications pratiques (par exemple, les budgets, l’évaluation et les délais) et administratives (par exemple, les procédures et l’éligibilité), ainsi que des annexes.
Cette variabilité s’applique également au contenu des propositions de projet, qui nécessitent généralement des éléments prouvant l’éligibilité et la capacité du porteur de projet et des partenaires, une proposition technique (besoins et contexte, approche, plan d’action et équipe de projet) et un budget.
Vous trouverez les détails dans lasection appropriée.
Quels sont les aspects importants à prendre en compte lors de la rédaction d'un projet ?
La rédaction d’un projet nécessite
– une lecture attentive de l’appel à propositions, pour vérifier sa correspondance avec les objectifs, les lignes directrices, le type d’activités et les critères d’éligibilité – une bonne analyse du contexte, des problèmes à traiter, des acteurs et des initiatives existantes – une formulation claire des objectifs et des résultats, un calendrier et la consolidation du partenariat – une vue d’ensemble et des moments de vérification conjointe, sur les aspects de l’innovation et de l’efficacité, de la pertinence et de la faisabilité – une volonté et une capacité à écrire de manière claire, simple et efficace, à approfondir et à améliorer.
Vous trouverez une discussion plus complète dans lasection appropriée.
Comment se tenir au courant des événements d'intérêt européen ?
Chaque année, d’importantes « journées européennes » et « semaines européennes » sont organisées pour rencontrer des fonctionnaires chargés de l’élaboration des politiques et des programmes européens, des organisations de tous les pays, des partenaires éventuels, des témoignages et des porteurs d’idées réussies. Nous avons rassemblé les dates des principaux événements dans un « calendrier » : il y en a vraiment pour tous les goûts.
A ces événements, il faut ajouter des « infodays » spécifiques organisés périodiquement par les différentes institutions lors du lancement de programmes spécifiques, de plans de travail et d’appels importants.
Les principales sources d’information sont : – la page des événements de la Commission européenne (les événements et ateliers organisés quotidiennement) ; – le service de diffusion en continu de la Commission européenne (accès aux enregistrements en direct des principaux événements) ; – les pages consacrées aux programmes européens, aux agences exécutives et aux points de contact nationaux (pour les journées d’information).
Vous trouverez tous les détails ici. Vous trouverez également plus d’informations dans notre manuel.
MÉTIER DE PROJECTEUR
Qu'est-ce qu'un "euro-projecteur" ?
Un euro-proposant se distingue des autres professionnels par sa connaissance des sources de financement et des procédures de gestion de projet propres à l’Union européenne et à ses institutions connexes. Toutefois, les euro-proposants ne constituent pas une catégorie « universelle » et le travail sur les projets européens est par nature diversifié et implique des « nuances » (et des compétences) différentes.
Quand et comment un Europlanner est-il utile ?
Le soutien d’un spécialiste du domaine, c’est-à-dire d’un « gestionnaire de projet européen », peut être un avantage lors de la préparation d’un projet, mais de nombreux facteurs doivent être pris en compte, notamment le type de projet, le type d’organisation et la manière dont l’organisation aborde la préparation de la proposition de projet. Même en présence d’un « euro-projecteur », l’organisation qui propose le projet doit faire preuve d’engagement et de vision.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Comment choisir un cours d'Europlanning ?
Nous préférons ne pas recommander de cours spécifiques d’Europlanning, car nous sommes conscients que l’offre est très large et différenciée en termes de couverture thématique et sectorielle.
Nous pouvons recommander un certain nombre de critères importants : le « curriculum » de l’organisation, le champ thématique déclaré, la présence d’applications pratiques, les compétences opérationnelles des conférenciers et le niveau d’approfondissement.
Pour en savoir plus, lisez l’article complet etdécouvrez les initiatives de soutien des partenaires du Guide ici.
Comment devenir un euro-projecteur ?
Il n’y a pas une seule façon de se spécialiser dans les projets européens. Il y a autant de parcours et d’expériences possibles qu’il y a de personnes qui s’appellent elles-mêmes « Europrojecteurs ».
D’une manière générale, nous considérons qu’il est important : – de « cultiver » les connaissances, l’expérience et les relations dans un domaine, de se former et de se tenir à jour ; – d’expérimenter la pratique sur des projets de manière progressive, avec un encadrement puis une autonomie croissante ; – de développer et de renforcer des compétences transversales en matière de rédaction, d’analyse, de reporting, d’organisation et d’utilisation d’outils informatiques.
Lisez l’article complet avec nos suggestions.
Comment et quand un chef de projet européen peut-il contacter directement les fonctionnaires de l'UE ?
Dans certains cas, il peut être utile ou nécessaire de pouvoir contacter les fonctionnaires de l’UE qui suivent la mise en œuvre des programmes et projets européens. Il existe pour cela des outils spécifiques et très efficaces, tels qu’un annuaire, un standard téléphonique et des pages consacrées aux différentes structures organisationnelles de la Commission européenne. Il convient toutefois de faire attention au qui, quand, comment et pourquoi : afin d’éviter des contacts inappropriés, contre-productifs ou contraires à l’objectif recherché.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Comment faites-vous du "lobbying" pour les projets européens ?
Le « lobbying » dans les projets européens (également appelé « advocacy », avec une nuance de sens différente) est un concept beaucoup plus « noble » et riche en contenu qu’on pourrait le penser : en effet, il s’agit d’une nécessité pour les institutions européennes, qui accueillent et écoutent avec intérêt les contributions de la société civile aux politiques européennes – qui se reflètent dans la programmation des projets de l’UE.
Il s’agit également d’un concept beaucoup moins « compliqué » qu’on pourrait le penser, car il existe de nombreuses organisations représentatives de la société civile auxquelles il est possible de se référer.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
POLITIQUES ET INSTITUTIONS
Par qui et comment le budget de l'UE est-il défini ?
La question est complexe, car le « budget de l’UE » comprend plusieurs aspects, chacun étant régi par une définition et des procédures d’approbation particulières. Il s’agit d’une question importante, car les fonds et les programmes utilisés dans la planification européenne découlent directement de ces procédures.
Les aspects décisionnels et budgétaires qui ont un impact sur les ressources des fonds et programmes européens concernent notamment : – les ressources disponibles pour la période de sept ans ; – l’organisation septennale des ressources (cadre financier pluriannuel) ; – le budget annuel de l’Union ; – les règlements des fonds et programmes européens (avec les priorités et leurs affectations).
Quelle est la durée de validité d'un "ancien" programme et quand un nouveau programme commence-t-il ?
Au début de chaque période de programmation, les anciens programmes sont épuisés, tandis que de nouveaux programmes sont progressivement lancés.
Les programmes de l' »ancienne » période restent pertinents pendant un certain temps.
En ce qui concerne les Fonds structurels, la règle dite « n+3 » s’applique : les activités peuvent être financées sur des projets jusqu’à la troisième année suivant la fin de la période de programmation. Le délai est normalement plus court pour les programmes européens gérés directement.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
De combien de fonds européens l'Italie pourra-t-elle bénéficier au cours de cette période de programmation ?
Une question fréquente et pas si simple.
La réponse dépend de plusieurs facteurs, paramètres et estimations qui peuvent être pris en compte dans le décompte. Nous avons fourni une estimation indicative de 350 milliards d’euros, avec une explication des paramètres pris en compte, sur la base desquels cette estimation peut varier. Ce guide vise à aider les organisations de notre pays à exploiter efficacement ce potentiel, par le biais de projets.
Découvrez les détails dans l’article dédié.
Fonds de relance : pourquoi est-il important et que change-t-il ?
NGEU, Next Generation EU, l’instrument (ou programme) pour la relance et la résilience ou (comme il est plus souvent abrégé) le Fonds de relance est une opportunité exceptionnelle pour notre pays.
Il s’agit d’un instrument unique et perturbateur, pour plusieurs raisons : – pour le montant des fonds mis à disposition (en particulier pour l’Italie), en temps de crise et à utiliser en quelques années ; – pour le sens de la solidarité entre les pays de l’UE et pour l’expérimentation d’une forme d' »euro-obligation » (avec laquelle une « dette publique européenne » a été créée) ; – pour l’introduction de critères et de structures de gestion et de contrôle des fonds coordonnés à plusieurs niveaux (UE et diverses autorités nationales).
Lisez l’article complet pour plus de détails.
Quelle est la capacité d'absorption des fonds européens ?
La capacité d’absorption des fonds indique la capacité à « faire bon usage des fonds ».
Elle mesure les aspects purement quantitatifs de l’utilisation des fonds et peut être appliquée de différentes manières : – quelle part des fonds initialement prévus est programmée pour une utilisation spécifique ; – quelle part de ces fonds est allouée aux bénéficiaires pour la mise en œuvre de projets ; – quelle part de ces fonds est effectivement dépensée pour des activités.
Selon les chiffres comparatifs fournis par CohesionData, l’Italie se classe normalement dans les dernières positions en termes d’utilisation des fonds, c’est-à-dire de capacité d’absorption. Cela signifie que les institutions italiennes sont moins efficaces dans la gestion des fonds, en termes opérationnels et administratifs, ce qui se traduit par une perte d’opportunités et de ressources.
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Existe-t-il un cadre commun d'objectifs et d'indicateurs défini par la communauté internationale ?
Oui, il existe et fait référence à ce que l’on appelle les ODD, ou objectifs de développement durable.Il y a 17 objectifs, divisés en 169 « cibles ». Chacun d’entre eux est lié à son propre système d’indicateurs.
Ils ont été adoptés par tous ceux qui sont impliqués dans le « développement » au sens le plus large : la coopération au développement, mais aussi le développement de leurs propres communautés, le développement économique et social et la durabilité environnementale. Quelle que soit l’ampleur (même mondiale) de leur horizon, un alignement (et une petite, voire très petite, contribution) de nos projets vers cet effort commun peut être utile. Un tel alignement peut également rendre les résultats de nos propres projets plus « communicables » (par le biais d’un langage commun).
Pour en savoir plus, consultez l’article complet.
Quelles sont les priorités de la période de programmation actuelle ?
Les principaux aspects stratégiques de la période de programmation actuelle (2021-2027) ont été définis par la Commission européenne sous la présidence d’Ursula von der Leyen (2019-2024).
Six priorités ont été identifiées. Certains sont spécifiquement associés à certains programmes de l’UE, mais tous sont d’une certaine manière pertinents pour tous les programmes et projets européens : Le « Green Deal » européen | Une Europe prête pour l’ère numérique | Une économie au service des personnes | Une Europe plus forte dans le monde | La promotion du « mode de vie » européen | Un nouvel élan pour la démocratie européenne
A celles-ci s’ajoutent (sans trop s’en éloigner) des priorités spécifiques liées à la politique régionale et aux fonds structurels : Une Europe plus compétitive et plus « intelligente » | Une Europe plus « verte » et à faible émission de carbone | Une Europe plus connectée | Une Europe plus « sociale » et plus inclusive | Une Europe plus proche des citoyens | Une meilleure gouvernance de la coopération | Une Europe plus sûre.
Lisez l’article complet ici.
Combien coûte l'Europe ?
L’Union européenne « coûte peu » : son budget représente environ 15 % de celui de l’État italien, alors qu’elle couvre une population presque huit fois plus importante.
Les dépenses de l’UE par habitant sont dérisoires par rapport à celles des autres administrations et les dépenses administratives très faibles (7 %) par rapport aux dépenses totales… qui sont principalement engagées dans les fonds et programmes européens.
Face à ces dépenses (somme toute modestes), le « coût de la non-Europe » est bien plus élevé. La BCE a estimé l’impact du marché unique « seul » à 12-22% du PIB européen par habitant, sans tenir compte d’autres facteurs et d’autres effets sur les citoyens (sécurité, innovation, droits, mobilité…).
Lisez l’article complet ici.
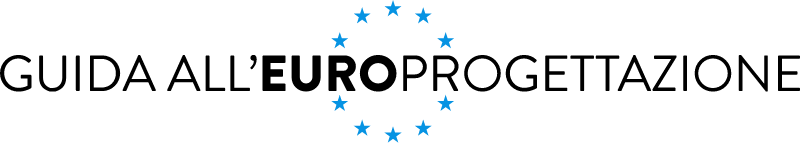








Gestion du partenariat : l’accord de consortium